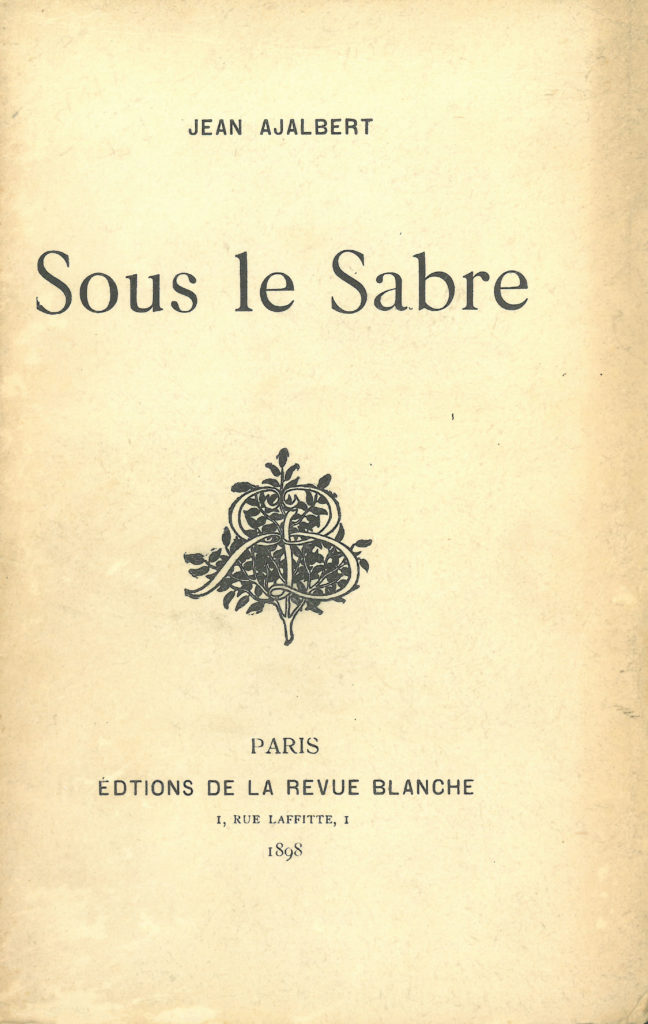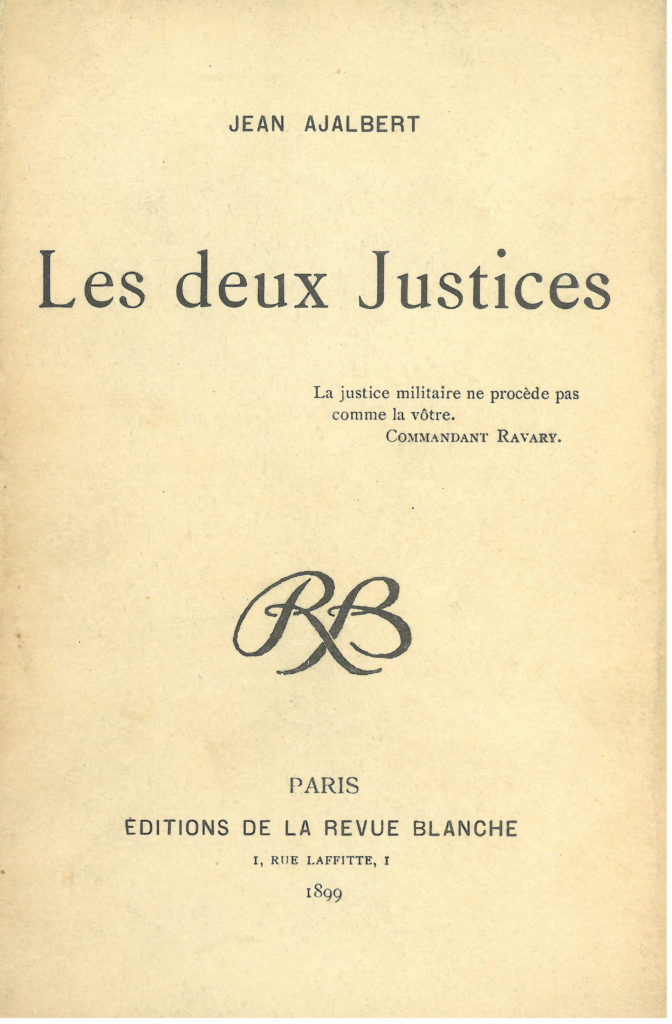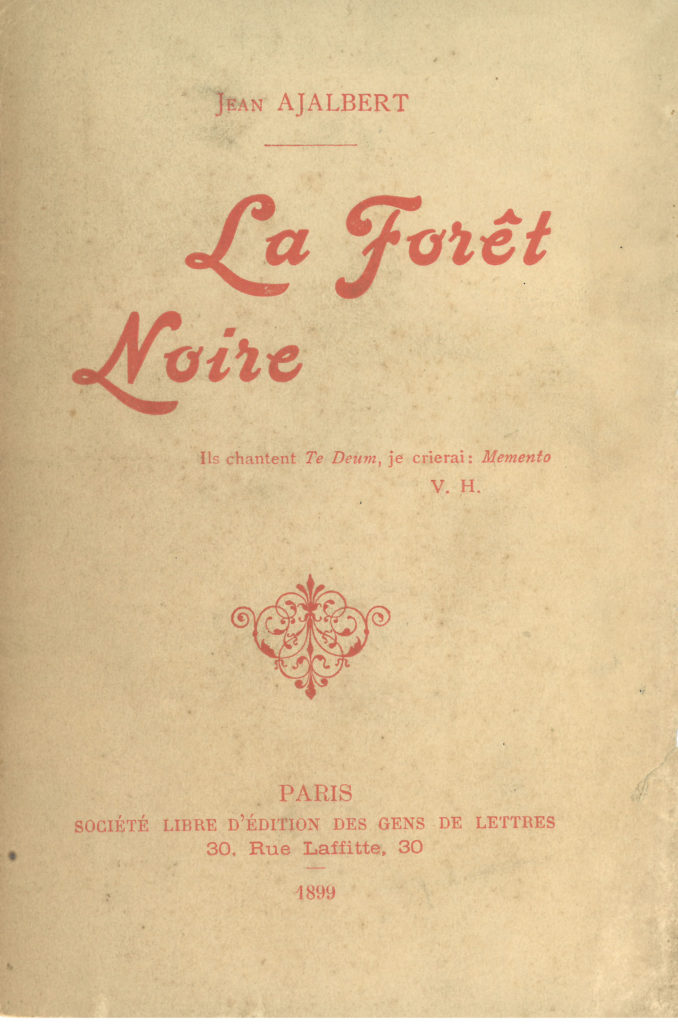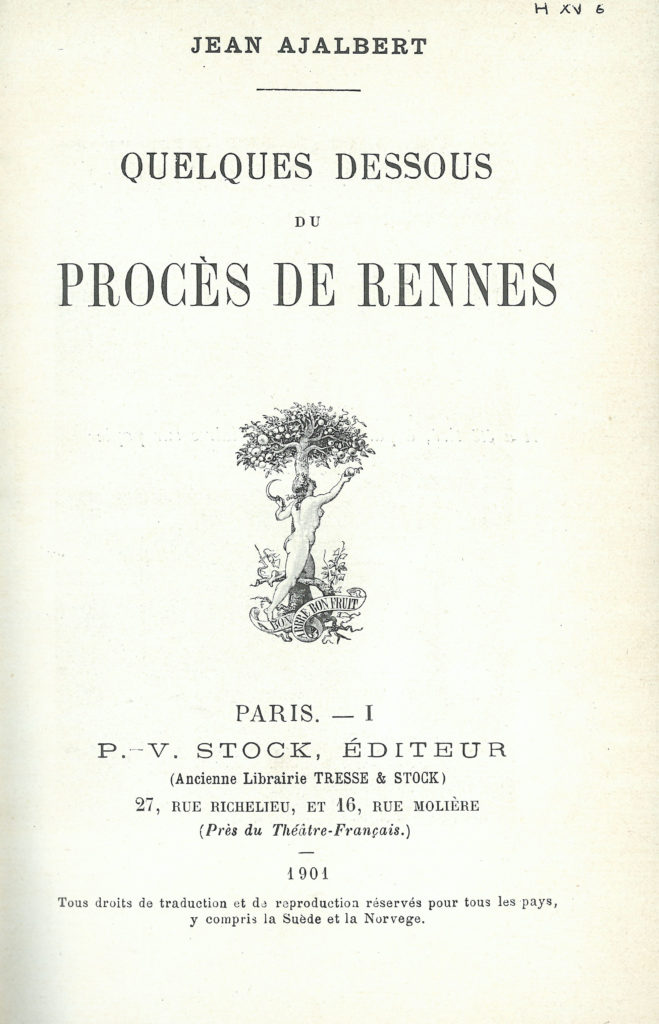Ajalbert, Jean, avocat et littérateur français, né à Levallois-Perret le 10 juin 1863*, décédé à Cahors (Lot) le 14 janvier 1947.
Poète impressionniste (Sur le vif, 1886 ; Paysages de femmes, 1887 ; Sur les talus, 1888), romancier proche des naturalistes (Le P’tit, 1889 ; En amour, 1890 : Le Cœur gros, 1894 ; Celles qui passent, 1898, etc.), adaptateur d’Edmond de Goncourt – dont il était un familier du Grenier – au théâtre (La Fille Élisa, 1891), Ajalbert collabora à la plupart des petites revues de la jeunesse littéraire : La Basoche, La Pléiade (les deux : 1886 et 1889), Lutèce, Le Symboliste, La Vogue, Le Carcan (qu’il fonda avec Paul Adam), La Wallonie, La Revue indépendante, Vendémiaire, etc. Il appartint aussi à la rédaction de nombreux journaux : Paris, Le Journal, L’Éclair, La Justice, etc. À partir de 1892, proche des milieux anarchistes, il fut souvent le régulier collaborateur de leurs publications (Le Pot à colle, L’Endehors, Le Plébéien, Les Temps Nouveaux) et leur avocat. N’ayant guère la vocation, souvent opposé au conseil de l’Ordre et dénonciateur d’une justice qu’il trouvait souvent bien injuste, il abandonna le barreau après le procès Vaillant pour lequel, refusant le simulacre, il avait renoncé de plaider.
Dès 1895, dans Gil Blas, il fut un des rares observateurs qui s’indignèrent de l’attitude du public venu nombreux assister à a dégradation de Dreyfus en rappelant que « la Loi a fixé les limites de la peine, qui ne comporte pas la curiosité, le mépris, les huées de la foule » : « Assister au supplice pour jouir des affres du supplicié, se bousculer à son passage, tendre des lorgnettes vers lui, proférer des cris et des outrages sur son chemin, c’est aggraver la peine, dépasser la justice ! » Il se révoltait contre le triste spectacle de cette « tourbe justicière, d’où éclataient les imprécations en réponse aux protestations de l’homme » :
Eux tous pourtant, qu’est-ce qu’ils savaient de lui ? Que ses juges l’ont jugé coupable. Mais ce n’est pas de ce crime, dont l’on ignore les détails, qu’il a été invectivé. Des indignations n’ont pu se contenir, ai-je lu : « Sale Juif ! » a-t-on crié sur son trajet. Sale juif ! Qu’est-ce que cela vient faire avec la mobilisation livrée ? Quelles notions confuses de la justice ! La patrie est-elle en cause ou les croyances religieuses ? Va-t-il falloir croire avec Pascal que « comme la mode fait l’agrément, elle fait aussi la justice », la mode de l’antisémitisme ? Ces chrétiens sans pardon, ces chrétiens justiciers, faudra-t-il leur rappeler les pardons du Christ, de qui ils se réclament ?
Et grande était sa tristesse de voir des confrères qui étaient aussi des amis participer et prolonger cette répugnante curée :
Qu’il est dangereux de se laisser emporter par la passion. Ont-ils bien suffisamment réfléchi, mon ami Léon Daudet, dans Le Figaro ; Barrès, dans sa réflexion de La Cocarde sur « La parade de Judas » qui ont écrit sur la minute même de leurs sensations lorsqu’ils ont dépeint la figure du traître comme étant manifestement celle d’un traître : basse, abjecte, etc. ? On l’injurie d’avoir marché d’un pas ferme tout le long de cette abominable promenade ; on l’eût injurié de même si son pas eût hésité ! Je me défie de ces instantanés, malgré tout le talent et la sincérité des auteurs.
« Il faudrait empêcher les sauvages de se mêler de l’appareil de justice », concluait-il (« Crime et châtiment », 9 janvier)…
Son premier acte militant, dès la fin de 1897, fut de quitter L’Éclair. Il s’en expliqua à son directeur, le 30 novembre 1897 :
Mon dernier article, annoncé par L’Éclair, n’a pas paru. J’y disais mon sentiment, différent du vôtre, sur l’affaire Dreyfus.
Je croyais L’Éclair absolument indépendant, comme il s’intitule.
C’était le moment de le prouver ; vous ne l’avez pas fait.
Je vous prie donc de recevoir ma démission.
Je n’ai plus rien à faire chez vous. Je m’en vais » (publiée dans le Mercure de France, janvier 1898, p. 350).
Mais c’est au lendemain de « J’Accuse… ! » qu’il s’engagea publiquement, signant la première protestation (1ère liste) et agissant pour que ses amis la signent (voir notice Carrière), participant à la souscription pour offrir une médaille à Zola (6e liste du Siècle et des Droits de l’Homme), à l’enquête de La Critique – où il affirma son admiration pour « l’attitude, le courage, la foi de Zola » : « Elle ne m’étonne pas. C’est le fier couronnement d’une vie de travail, de lutte et d’honneur. C’est l’aboutissement fatal d’un libre esprit, passionné d’humanité » (no 71, 5 février 1898) –, et menant combat jusqu’au verdict de Rennes : deux ans de chroniques batailleuses qu’il considérera, plus de vingt ans après, comme « le meilleur moment de [s]a vie » (Les Nouvelles littéraires, 9 juin 1923). À l’été 1898, il participa à la souscription du Siècle en réponse à l’affichage du discours de Cavaignac (1ère liste) et, la fin de 1898, il signa encore la protestation en faveur de Picquart (3e liste). Ajalbert s’engagea totalement et, ainsi qu’il le dira plus tard, « avec d’autant plus de fougue que rien ni personne ne pouvait contrarier [s]on élan. En instance de divorce, seul, avec un enfant de trois ans, toutes [s]es forces se dépensaient dans l’Affaire où [il] oubliai[t] [s]es tristesses et [s]es intérêts privés » (Mémoires à rebours, Paris, Denoël et Steele, 1936, p. 249).
Après son départ de L’Éclair, il rallia la rédaction des Droits de l’Homme, nouvellement créés, où il publia de très nombreux articles d’une grande vigueur : « […] du dégoût, du mépris, de la colère, de la haine, de la passion, et tout ce qui s’ensuit : des gros mots, de l’injure, de la violence, même des coups de pied au cul de l’adversaire, qui ne se retourne pas toujours : ce qui ne l’empêche pas d’avoir senti… » (préface à Sous le sabre, p. v – Les Droits de l’Homme, 4 mai). Des articles qui firent de lui, selon le journal Le Temps, un « redoutable polémiste » et qui de ce fait ne furent pas toujours appréciés des défenseurs les plus légalistes du capitaine. Ainsi, après la publication de son article publié dans le numéro en date du 23 janvier qui appelait à guillotiner les généraux, Scheurer-Kestner écrivit à Reinach pour lui dire combien il le trouvait « déplorable » : « Ce n’est plus de l’imprudence ni de l’impudence, ajoutait-il, c’est de la démence. Les imbéciles ont toujours gâché les meilleures causes » (lettre du 22 janvier 1898, BNF n.a.fr. 24898, f. 295).
Dénonciateur de l’antisémitisme, contempteur de l’État-major et des généraux, des nationalistes et des antisémites, de la « Ligue des Poires » et de la Ligue de la patrie française, de Félix Faure et de ses ministres, des parlementaires qui se taisaient ou comme Poincaré et Barthou parlaient bien tard (« Trop… et pas assez… », Les Droits de l’Homme, 3 décembre 1898 – La Forêt noire, p. 39-43), de l’Église qui « depuis trente ans […] espère l’aventurier qui étranglerait la Gueuse, – promettant d’absoudre, une fois de plus, le soldat, qui lui prêterait la force, le juge, qui simule le droit » (préface à La Forêt Noire, p. III) –, des persécutions dont était victime Picquart, « plus qu’un crime » (Les Droits de l’Homme, 1er décembre 1898 – La Forêt noire, p. 71-75), des journaux esterhazistes et de leurs directeurs, il eut de nombreuses et violentes polémiques – se montrant parfois un peu pour le moins susceptible (voir notice Bartholomé) – avec ceux qu’il prenait pour cible, tel Vervoort qu’il rencontra en duel en janvier 1898 (voir L’Intransigeant, 23 janvier 1898). Et de ces articles nombreux, il fera trois volumes : Sous le Sabre, Les Deux Justices et La Forêt Noire, songeant « aux vingt ans qui vont suivre. Il peut être intéressant, certains soirs, de se documenter sur certains hommes ; certains livres pourront être utiles ; ils se gardent plus aisément que des collections de quotidiens » (« L’amnistie », Les Droits de l’Homme, 28 octobre 1899).
Symbole du littérateur engagé, défenseur infatigable de « la mission sublime » de l’écrivain dont Zola devint pour lui le héraut, Ajalbert n’eut de cesse de prendre à parti ses « chers confrères ». Ainsi, dès le début de son engagement, ulcéré que certains, « valets de l’opinion » et « savetiers de lettres » (« Les valets de l’opinion » et « Les complices », Les Droits de l’Homme, 16 et 20 janvier 1898 – Sous le sabre, p. 11-32), se tinssent à l’écart de la bataille pour des questions marchandes, il décida de les contraindre à se déterminer en les attaquant (voir notices Arène, Brieux, Case, Calmette, Hervieu, Lavisse, Le Roux, Rostand, Sardou), puis, finalement – occasion aussi de malmener Fernand Xau et l’antidreyfusard Journal –, en publiant un « Hommage à Zola » (Les Droits de l’Homme, 2 mars – Sous le sabre, p. 172-177) signé, sans les avoir consultés pour les obliger à prendre parti, par eux.
En 1899, il écrivit aussi au Journal du Peuple où il retrouvait ses amis anarchistes. Il fut non seulement un des rares, à l’annonce de la révision, en 1899, à se souvenir et à célébrer Bernard Lazare (« Le palmarès », Le Journal du Peuple, 13 juin), qu’il n’oubliera pas non plus par la suite, faisant partie, en 1905, du Comité d’initiative du monument nîmois. Une révision pour laquelle, bien avant l’arrêt, il avait – un des rares encore – défendu l’idée de la cassation sans renvoi :
[…] si les magistrats sont pénétrés de l’innocence de Dreyfus, ce serait un crime de le jeter à l’État-major, aux Boisdeffre et aux Pellieux. Ils condamneraient malgré tout – quand même. […] Que les magistrats aillent jusqu’au bout, aussi. S’ils ne sont pas éclairés suffisamment, qu’ils le disent. Mais s’ils croient à l’erreur, au crime judiciaire qu’ils le proclament aussi, sans transactions : tout leur courage n’aurait servi de rien, s’ils s’en rapportaient aux juges militaires le soin de réparer. (« La cassation de la cassation », Les Droits de l’Homme, 21 janvier 1899 – La Forêt noire, p. 101-104).
À Rennes – dont il fera un livre (Quelques dessous du procès de Rennes), il fut des mécontents qui n’acceptèrent pas la mise à l’écart de Labori et la tactique adoptée par Demange :
Oh ! quelle consternation devant la parole de Demange, le silence de Labori ! Eh ! quoi, à la dernière minute, dans la bouche de Demange, l’immonde Henry redevenait un excellent soldat, et les généraux de fonds secrets comme Billot, les généraux de complot comme Roget, le généraux de bagne comme Mercier se trouvaient de loyaux soldats ! C’est pour qu’un avocat timoré et trompé vînt dire ça, vînt proposer nos plates excuses à tous ces bandits, que nous les avions acculés aux gendarmes, jetés au seuil du cachot ! […]
Oh ! Demange est le parfait honnête homme ! Sans doute, il a longuement prié son Dieu de lumière, avant d’agir – et son Dieu, qui est celui de Mercier, – l’a mis dedans, et Dreyfus aussi, et nous tous ! (« Réflexions toutes personnelles », Les Droits de l’Homme, 22 septembre 1899).
Il reviendra sur le sujet, un peu plus tard, durcissant sensiblement le ton :
La bande compacte des “Chargeurs réunis” ne trouva devant elle qu’une défense dissociée, paralysée.
La tactique de la courbette aux juges du Conseil de guerre, et de l’éponge aux gredins de l’État-Major devait prévaloir.
L’assassin de Me Labori n’eut pas de plus sûrs complices que les partisans de la paix à tout prix.
Me Labori s’était remis de sa blessure. Il ne se rétablit pas de son absence aux débats.
Les malins de la presse et de la politique avaient remarqué tout de suite que tout se passait bien gentiment, quand Me Labori n’était pas là. Plus d’incidents d’audience, plus de dialogues violents à la barre, plus de témoins poussés à bout, plus de heurts, plus de secousses !…
Quelle sérénité chez les juges !… Et voilà que ressuscitait le trouble-fête…
Il exaspérait le général Mercier, le président Jouaust…
Et ses amis lui tiraient dans le dos, comme l’homme du quai de la Vilaine…
Et, pourtant, puisque c’est Me Labori qu’on redoutait, puisque c’est Me Labori dont on voulait se débarrasser, c’est Me Labori qu’il fallait garder…
« Que Labori se taise et c’est l’acquittement », voilà ce qui s’écrivait, à peu près, dans des lettres autorisées de Paris qui circulaient à l’audience, passaient sous les yeux mêmes de l’avocat [voir notice Cornély].
Et comme après deux ans de peines et de luttes, à la minute suprême, il ne voulait pas déserter, ce fut à peu près officiellement, par ordre, sur une démarche faite près de lui, le dernier jour, à cinq heures du matin, qu’il dut se taire, déposer les armes.
Mathieu Dreyfus, la famille, les amis, les tacticiens, les figaristes ou révolutionnaires, tous opinaient pour la retraite :
– Tout d’un coup, je me suis aperçu que j’étais tout seul, aurait dit Me Labori…
[…]
Tant mieux pour lui. S’il avait parlé, on l’eût fait responsable de la défaite. Et les plus éloquentes paroles n’eussent pas ajouté à sa gloire. Quoi qu’il arrive, par son courage, par sa foi, par son talent, par le sang versé, il demeure l’avocat de la vérité, de la justice, sinon de Dreyfus (Quelques dessous du procès de Rennes, p. 247-249).
Logiquement, se rangeant du côté de Labori et de Picquart contre les « politiques », il condamna la grâce :
[…] pendant ces deux années de luttes, nous nous étions battus pour la justice : nous n’avons conquis que la banale et facile et lâche pitié.
[…] Dreyfus est gracié, libre.
La grâce peut satisfaire les amis de Dreyfus. Elle ne saurait contenter les amis de la justice (« Réflexions toutes personnelles », Les Droits de l’Homme, 22 septembre 1899).
Déçu, aigri, il ne pardonnera jamais aux « amis de Paris », « chefs coutumiers de la défaite », autrement dit Reinach, Cornély et les Dreyfus, de s’être, à Rennes, « laiss[és] battre par ordre » (ibid.). Il leur reprochera aussi, assez injustement, d’avoir « liquidé » l’Affaire, d’avoir « crevé les Droits de l’Homme qui pouvaient vivre […] et refusé les concours les plus sérieux qui s’offraient pour les faire vivre », écrira-t-il le 24 janvier 1900 à Stock. Et d’ajouter :
[…] il fallait nous éliminer quand même – comme, par la suite, Clemenceau et aujourd’hui Gohier, comme ils avaient expédié B. Lazare. Vous devinez bien que, lorsqu’ils n’auront plus besoin de vous, ils auront tôt fait de vous tirer leur chapeau. L’éditeur des Livres Rouges [la Bibliothèque sociologique de Stock qui publiait les anarchistes] n’est pas leur homme. Alors ils retourneront chez Ollendorf (sic), Lévy et tous les libraires juifs qui n’ont pas marché » (citée in Stock, Mémorandum…, p. 192-193).
Mais surtout, Ajalbert reprochait aux « amis de Paris », aux « Juifs » donc, qui « pour démontrer leur loyauté, […] sont obligés, paraît-il, de ne pas rater l’occasion de prendre parti contre nous » (lettre à Stock du 12 novembre 1900, ibid., p. 254), de l’avoir personnellement écarté, de l’avoir, comme il l’écrira bien plus tard à Joseph Reinach, « saqué de tous les journaux et surtout des nôtres après l’affaire » (BNF n.a.fr. 13527, f. 29, lettre du 12 février 1913). C’est ce qu’il expliquera encore dans ses souvenirs :
Il en coûte d’avoir été le « redoutable polémiste ». Tous les journaux m’étaient fermés. – Je redeviendrai « conteur »… Je ne signerai pas…
Rien à faire. Trop voyant. Ah ! on penserait à moi ! Cependant, les tièdes et les neutres occupaient les places. Joseph Reinach me proposait La Lanterne. mais les “groupes politiques” veillaient (Les Mystères de l’Académie Goncourt, p. 188).
En fait, les journaux dreyfusards avaient pour ainsi dire tous disparu ou connaissaient de très sérieuses difficultés (voir L’Aurore et Les Droits de l’Homme) et les autres, antidreyfusards ou sagement neutres pendant l’Affaire, ne voulaient s’embarrasser du « redoutable polémiste ». Les juifs, coupables à ses yeux d’avoir « rejeté les écrivains dreyfusards de leurs journaux et de leurs entreprises » (Ces phénomènes, Artisans de l’Empire, Avignon, Aubanel, 1941, p. 13. Cité in Epstein, p. 100), n’y étaient vraiment pour rien. Ajalbert noircit d’ailleurs quelque peu le tableau en se présentant comme un paria au sein de son propre camp. En effet, lors de la reconstitution de la rédaction de L’Aurore, le 11 juin 1902, Ajalbert, qui en mai venait d’y publier un article, fut donné dans la liste des collaborateurs. Mais il n’y publiera plus pour une raison que nous ignorons. Plus que les juifs ou les « amis de Paris », le principal responsable de cette mise à l’écart n’était-il pas Ajalbert lui-même qui, avec son volume paru en novembre 1900, Quelques dessous du procès de Rennes, dans lequel il réglait quelques comptes avec les « épongistes », ne s’était pas fait que des amis ?
Sans plus de ressources, alors, il trouva alors pour subsister, grâce à son ami Briand, des missions en Indochine (séjours qui lui inspirèrent deux romans et une étude : Sao Van Di, 1905 ; Raffin Su-Su, 1911 ; Les Destinées de l’Indo-Chine, 1911). Entre deux voyages, il collabora à L’Humanité (où il donna, de sa création, en avril 1904 à mai 1905, des « Propos de Paris et d’ailleurs ») et à L’Action (dans lequel il publia régulièrement de mars 1904 à janvier 1905 et auquel, au printemps 1905, il donna en feuilleton son roman Sao Van Di).
De retour en France, il souscrivit au monument Cornély (1ère liste), collabora au Gil Blas, à La Dépêche de Toulouse,à la France Libre (à partir de 1918), etc., et fut nommé conservateur du château de la Malmaison, poste qu’il occupa de 1907 à 1917, puis administrateur de la Manufacture de Beauvais. Il collabora encore à quelques journaux dont au Courrier Saïgonnais auquel il envoyait des « Courriers de Paris ». Il se consacra ensuite entièrement à son activité littéraire et à l’académie Goncourt où il avait été élu en 1917.
Plus tard, écrivant ses souvenirs, il reviendra sur son engagement dreyfusard, ne reniant rien de ce qu’il avait fait mais demandant de ne pas rouvrir « les quatre recueils où dorment mes articles des Droits de l’Homme [références données en bibliographie] » : « Je ne donnerai même pas les titres. Il s’y rencontre des articles que je regrette. On écrivait toujours sous pression, sans aucun ménagement » (Les Mystères de l’Académie Goncourt, p. 176).
Pendant l’Occupation, ses amitiés, quelques publications dans la presse collaborationniste (L’Appel, L’Émancipation nationale, Revivre, Panorama, Les Cahiers franco-allemands, Germinal), sa signature donnée au « Manifeste des intellectuels français contre les crimes anglais » de 1942, ses prises de positions doriotistes (« Ce que pense du départ de Jacques Doriot : Jean Ajalbert de l’Académie Goncourt », L’Émancipation nationale, 10 avril 1943), son action d’académicien Goncourt au service du pouvoir et de ses chantres lui valurent, à la Libération, de faire partie des auteurs interdits par le CNE. Il ne parla guère de l’Affaire dans les articles qu’il publia pendant l’Occupation mais donna toutefois à Revivre. Le grand magazine illustré de la race, un « Mes bons juifs… Léon Blum » dans lequel il se souviendra d’un dreyfusisme qu’il n’était plus aisé de soutenir : « ça a failli mal tourner pour moi. C’est-à-dire que les Juifs ont été sur le point de m’enjuiver jusqu’où ! J’ai cru, et continue à croire à l’innocence du sinistre Capitaine. Dans mes campagnes des Droits de l’Homme, où je ne me battais pas que de la pointe du stylo, j’avais montré quelque vigueur de polémiste. On pouvait m’utiliser. D’autant plus que ça ne coûterait pas cher. Ils en avaient fait l’expérience aux Droits de l’Homme » (n° 14, 24 octobre 1943).
Tenant de l’Art social, engagé parce qu’estimant que tel était son devoir, le « radical » Ajalbert – qui espérait « qu’un jour, quelqu’un dise d[’eux] tous, depuis Zola jusqu’au plus humble de ses amis : “ils aimèrent la vérité, ils voulurent la justice…” Nous ne souhaitons rien de plus » (Sous le sabre, p. XVIII) – fut une des grandes figures du dreyfusisme de plume, mais différent de Gohier, avec qui on le compara parfois, en ce qu’il fut toujours vigoureux sans violence inutile, « gai et joyeux », comme le dira de lui Léon Blum qui le décrira encore comme allant chaque jour au combat avec « une belle vaillance claire et ensoleillée qui réconforte et qui réjouit ».
Sources et bibliographie : Une grande partie de ses articles des Droits de l’Homme relatifs à l’Affaire a été reprise en trois volumes : Sous le Sabre (Paris, Éditions de La Revue Blanche, 1898), Les Deux Justices (Paris, Éditions de La Revue Blanche, 1899), La Forêt Noire (Paris, Société Libre d’Édition des Gens de Lettres, 1899). Ses Dessous du procès de Rennes, illustrés de photographies de Gerschel, ont été publiés chez Stock à la fin de 1900 (daté de 1901). Il a laissé des souvenirs sur l’Affaire dans son volume Les Mystères de l’Académie Goncourt (Paris, J. Ferenczi et Fils éditeurs, 1929, p. 174-189). Sa contribution à l’enquête de La Critique a été en partie reprise dans Les Cahiers Naturalistes, no 72, 1998, p. 173. Sur son action pendant l’Occupation, on pourra se reporter à Gisèle Sapiro, La Guerre des écrivains 1940-1953, Paris, Fayard, 1999 et à Epstein, p. 99-101. Sur son dreyfusisme, voir Oriol, passim et Naquet-Manceron, p. 59-62. Son dossier de la Légion d’honneur se consulte à la cote : 19800035/371/49870.
Philippe Oriol


Musée de Bretagne, Collection Arts graphiques